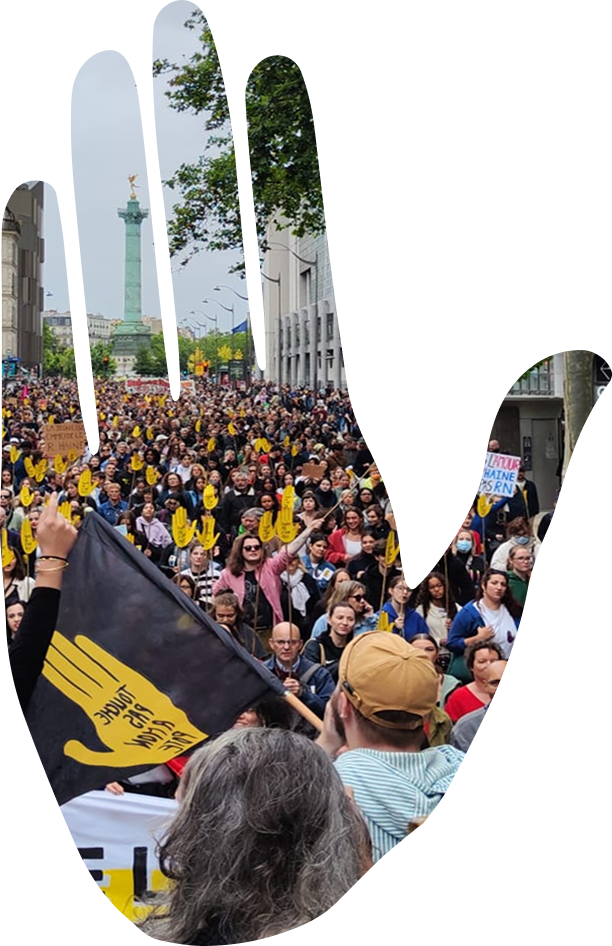Le jeudi 12 février, en marge d’une conférence donnée par l’eurodéputée Rima Hassan à Sciences-Po Lyon, une violente altercation a conduit à la mort d’un jeune militant d’extrême droite. A 23 ans, Quentin Deranque a succombé à ses blessures. L’enquête déterminera l’enchaînement des faits ainsi que les responsabilités individuelles dans la survenue de ce drame. Mais, quoi qu’il en soit, le lynchage de ce jeune homme n’est en aucune manière admissible. La violence ne peut jamais faire partie, à l’exception de la défense face à une agression, d’une ressource politique légitime dans une République telle que nous la concevons et encore davantage au sein de la gauche.
Le poète Ramuz disait « la nature est de droite, l’homme est de gauche ». Il voulait par-là signifier qu’être de gauche, c’est toujours croire que l’homme peut s’améliorer, progresser, devenir une version améliorée de lui-même, là où la droite fixe les individus dans une nature immuable. C’est ce rapport à l’homme qui contribue à nourrir l’aversion pour la peine de mort qui traverse très largement les familles de pensée situées à la gauche de l’échiquier politique. Que serait devenu Quentin Deranque ? Il est dur d’imaginer qu’il serait devenu un citoyen épris d’égalité et de fraternité. Et pour cause : ce qui le caractérisait sur le plan de l’engagement est son enracinement à l’extrême droite où les fémonationalistes de Némesis, les maurrassiens de l’Action française et les nationalistes-révolutionnaires d’Audace se disputent d’ores et déjà sa mémoire afin d’en faire un martyr issu de leurs rangs. Mais, l’âge venant, il se serait sans doute « rangé des voitures », aurait peut-être fondé une famille, aurait gagné en « rondeur » intellectuelle, serait devenu plus tolérant. Ou pas, m’objectera-t-on. Peut-être. Mais nous n’en savons rien. Et quand bien même il se serait abandonné à une trajectoire pavée de haine, il n’en serait pas moins resté un être de droit. Et tout être de droit répond de ses éventuels actes répréhensibles devant la justice et de son idéologie contestée dans l’arène politique. Certainement pas sous les coups portés par des poings et des pieds au détour d’une rue.
Cette mort, qui pourrait aboutir à des condamnations pour homicide volontaire, n’exonère en rien l’extrême droite de sa propre violence, dont il est juste de rappeler qu’elle est de loin, en matière de violence politique, la plus meurtrière.
Cette mort n’interdit pas de penser que l’attention médiatique portée à cette affaire est bien plus profonde que celle qui se porte sur les exactions de l’extrême droite. Le meurtre de Djamel Bendjaballah en août 2024 par un militant d’extrême droite en est une expression caricaturale.
Cette mort n’interdit pas de penser qu’elle est exploitée jusqu’à la nausée par une extrême droite qui y trouve une façon d’avancer son agenda de normalisation. Après avoir bénéficié d’une complaisance médiatique crasse qui a abouti à une mise en équivalence entre l’extrême gauche et l’extrême droite, cette même extrême droite, qui n’a évidemment rien cédé à son programme raciste et antidémocratique, a semblé ces derniers jours avoir antennes ouvertes pour tenter de rejeter la gauche dans le camp de l’illégitimité démocratique.
Cette mort ne peut nous détourner du constat de la différence spectaculaire de la réaction de quelques responsables politiques face à la violence physique, à l’image de Bruno Retailleau. Prompt à condamner « l’extrême gauche » à la suite de la mort de Quentin Deranque, il refusa, alors qu’il était ministre de l’Intérieur et donc chargé des Cultes, de se rendre dans la mosquée de La Grand-Combe (Gard) après le meurtre qui y frappa Aboubakar Cissé au printemps.
Cette mort ne doit pas non plus occulter que, depuis des années, le centre-ville de Lyon, dans une coupable inaction de la part des pouvoirs publics, est devenu un terrain de jeu de toutes les nuances de l’extrême droite dont les agressions et exactions multiples et constantes suscitent un spectaculaire désintérêt. D’ailleurs, la mort de Quentin Deranque ne s’inscrit manifestement pas dans le cadre d’un guet-apens comme il a été dit. Elle s’inscrit dans un affrontement de type hooliganiste entre milices d’extrême droite et activistes antifascistes.
Cette mort ne doit pas davantage nous divertir d’un constat : lorsque l’extrême droite tue un militant antifasciste (il n’est qu’à penser à Clément Méric), la gauche – milieu antifasciste compris – ne crie pas à la vengeance et ne commet pas d’exactions. Lorsque la gauche, dans une de ses nuances d’antifascisme, est mise en cause, l’hallali est le réflexe à peine contenu de l’extrême droite milicienne. Les dégradations de locaux de partis de gauche, les menaces de mort qui déferlent sur les réseaux sociaux à l’endroit des militants antifascistes ou l’alerte à la bombe qui a conduit à la brève évacuation du siège de LFI le montrent suffisamment ces dernières heures.
Ces réalités sont sans cesse à rappeler à celles et ceux qui trouveraient dans la mort de Quentin Deranque matière à cesser de faire barrage à l’extrême droite.
Le moment que nous vivons pose cependant la question du rapport concret à la violence.
Sans vouloir ouvrir de polémiques ou déployer des analyses définitives sur une séquence pénible et dont les tenants et les aboutissants restent à préciser, il est grand temps que la lutte contre l’extrême droite substitue à nouveau la réalité de la force à l’imaginaire de la violence qui l’a progressivement gangrenée. Toute formation politique qui, par le choix de ce qu’elle laisse prospérer en son sein ou à ses marges, favorise l’imaginaire de la violence ne peut ignorer sa responsabilité dans les progrès de l’extrême droite à laquelle, par effet de miroir, elle offre un funeste contrepoint. Cet imaginaire de la violence est évidemment favorisé par des logiques de conflictualisation dans lesquelles un « Nous » est présenté comme étant aux prises avec des ennemis ou avec des traîtres, par la mise en scène de l’absence d’empathie et par l’absence de clarté – dans la constance et au-delà des seuls discours officiels – face à une jeunesse que l’on n’aide plus à percevoir la différence entre la violence et la force au risque de favoriser la première.
A cet égard, Jean-Luc Mélenchon – régulièrement d’ailleurs à rebours du cœur de son électorat et de l’appareil militant de LFI – occupe un positionnement lourdement questionnable. Car, au-delà de l’éthique qui le sous-tend, ce positionnement, d’autant plus lorsqu’il se fait au nom d’un mouvement politique conséquent et qui se présente comme ayant une vocation majoritaire, emporte des conséquences délétères sur la capacité de la gauche à sortir de son ornière électorale.
La question stratégique pour la gauche et pour un camp antiraciste qui ne se confond pas avec elle – il la déborde sans la recouvrir entièrement – est évidemment cruciale. Car, alors que l’extrême droite déverse son narratif victimaire sur les plateaux de télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et dans tous les canaux de communication à sa disposition, il s’agit de faire obstacle à ce camp politique dont il faut sans cesse rappeler qu’il représente le danger central pour notre démocratie. Et s’il représente ce danger central, c’est en raison de deux réalités.
Tout d’abord, l’extrême droite – et notamment sa variante fascisante où culminent les processus de déshumanisation – est bien le camp de la violence. Son bilan rappelé brièvement plus haut le montre suffisamment, sans qu’il soit même besoin de remonter dans un passé qui le montrerait tout autant. Et il ne saurait en être autrement puisque la violence fait partie de son ADN. Violences envers les militants de gauche, envers les étrangers et leurs enfants, envers les musulmans, envers les homosexuels ou les trans : si l’extrême droite n’a pas le monopole de ces types de violences, elle est la seule force politique constituée à les exercer. Et il serait assez oiseux de tenter d’opérer sur ce plan une différenciation entre une extrême droite milicienne et une extrême droite partidaire. Car nous sommes ici devant les deux faces d’une même médaille. A la suite du meurtre du jeune Thomas Perotto à Crépol (Drôme), les milices d’extrême droite avaient tenté d’organiser des ratonnades. Le Rassemblement national (RN) et Reconquête, dans un contexte où la séquence leur semblait suffisamment favorable, s’étaient bien gardés de condamner ces expéditions racistes. Leur fascination pour Trump, sa brutalité verbale et les rafles anti-immigration organisées par l’ICE [Immigration and Customs Enforcement, Service de l’Immigration et des Douanes, NDLR] dit encore plus clairement ce que serait leur pratique du pouvoir.
Ensuite, l’extrême droite est bien la force politique qui, aujourd’hui, met en danger la démocratie. Elle est la force politique qui peut s’emparer du pouvoir sur la base d’un programme d’affrontement à la Constitution en ce que celle-ci protège les principes d’égalité et de liberté honnis par un personnel profondément acquis à un imaginaire raciste, antisémite et xénophobe. Alors, il appartient à la gauche d’offrir des débouchés à la lutte contre l’extrême droite et à la lutte contre le racisme que ce camp charrie. Car, aujourd’hui, l’alternative apparaît terrible et à chaque fois perdante. La gauche dite « de gouvernement », trop souvent repliée sur une mentalité d’héritiers de 1981 à l’héritage épuisé, incarne une absence de débouché au-delà de quelques formules fatiguées qui n’entraînent rien dans la société. La gauche dite « de rupture » prétend offrir un débouché qui prend les traits de la combativité mais dont la réalité est tragique : la brutalité, le clivage permanent ou la désignation de traîtres à la cause. Ces traits détestables permettent sans doute de « bétonner » un camp mais ils mènent à une défaite assurée contre toute autre force politique, extrême droite comprise.
Pour notre part, nous poursuivons notre chemin. Celui d’un antiracisme qui ne se demande pas qui, des juifs ou des musulmans, il faut défendre. Un antiracisme qui dénonce, malgré le large désintérêt médiatique et politique que cela suscite, le caractère massif des discriminations raciales ou des agressions racistes qui écorchent des vies. Un antiracisme dont la non-violence fait partie de son ADN militant.
Lors du meeting de Villepinte qui lança la campagne présidentielle de Zemmour le 5 décembre 2021, nos militants – agressés par des nervis fascistes pour avoir simplement scandé et formé avec leurs corps le slogan « Non au racisme » – ne répondirent pas aux coups. Nous n’oublions d’ailleurs pas qu’à l’époque, celles et ceux qui aujourd’hui s’indignent à la droite extrême et à l’extrême droite de l’échiquier politique de la mort de Quentin Deranque n’avaient pas hésité à parler de « provocation » de nos militants. Ces dernières années, cette non-violence de SOS Racisme a parfois été moquée, contestée ou dévaluée, à l’occasion dans quelques ricanements. Fait au demeurant notable : aucun ricanement parmi les militants de la Jeune Garde qui exprimèrent alors beaucoup de respect.
Qu’ils soient le fait d’esthètes de la radicalité ou d’irresponsables, ces ricanements doivent faire place à une réévaluation urgente du rapport de toutes les nuances de la gauche au combat contre l’extrême droite et le racisme.
L’enjeu n’est pas mince. Car contrer la dynamique électorale de l’extrême droite est non seulement un enjeu démocratique mais également un enjeu pour la protection de millions d’hommes et de femmes que leur couleur de peau, la consonance de leur nom, leur nationalité ou leur religion risquent de livrer aux violences juridiques, institutionnelles, symboliques et physiques que l’extrême droite leur promet. Ici, point d’esthétisme mais la réalité des vies que l’inconséquence politique semble mettre chaque jour un peu plus en suspens.